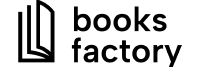Le nouveau roman de Suzanne Collins figure parmi les livres les plus attendus de 2024. En moins d’une semaine, Lever de soleil sur la moisson est devenu numéro 1 sur Amazon. La première édition est tirée à 1,5 million d’exemplaires.
Cela n’a rien de surprenant : la saga Hunger Games s’est vendue à plus de 100 millions d’exemplaires dans le monde. Collins est une star mondiale. Ses livres sont traduits, adaptés, étudiés. Surtout, ils rapportent. Beaucoup.
En 2022, les revenus de Suzanne Collins étaient estimés à 20 millions de dollars, ce qui la plaçait dans le top 10 mondial des auteurs les plus rémunérés.
Mais, que nous dit ce chiffre, sauf le fait que certaines autrices savent parfaitement naviguer dans un système dominé par les grands groupes d’éditions, les studios de cinéma et les géants du commerce en ligne ?
Peut-être ceci : le succès spectaculaire de quelques écrivains masque une réalité économique bien plus dure pour la majorité des auteurs.
Les écrivains français ne vivent pas de leurs livres
Selon une étude menée par la Société des Gens de Lettres (SGDL), plus de 80 % des écrivain·es professionnel·les en France gagnent moins que le SMIC grâce à leur activité littéraire. Le revenu médian annuel issu du droit d’auteur est inférieur à 5 000 €.
Le Centre national du livre (CNL) confirme ces chiffres : la plupart des auteurs ont besoin d’une autre source de revenu (enseignement, journalisme, résidence ou activité artistique complémentaire) pour vivre décemment.
De plus, la précarité s’accentue : le nombre d’auteurs touchant des revenus réguliers baisse et les revenus issus de la chaîne du livre (droits papier, poches, cessions de droits, adaptations) se concentrent sur une minorité.
Pourquoi en parler maintenant ?
Parce que le cas Collins illustre le paradoxe du système : plus les quelques stars du marché gagnent, plus le reste de la profession semble invisible.
C’est aussi une question politique : faut-il défendre un modèle culturel dans lequel seuls les plus visibles sont rémunérés dignement ? Que deviennent les récits plus exigeants, les formes moins commerciales, les premiers romans brillants, mais fragiles ?
On entend souvent dire que « la littérature trouve toujours son chemin ». Mais, ce chemin devient de plus en plus étroit et seuls certains y sont invités.
À suivre ou à ne pas suivre
Cela ne signifie pas qu’il faille boycotter les grandes sagas ou les auteurs populaires. La plupart du temps, leur talent est réel, leur travail, colossal, et leur succès, mérité.
Toutefois, peut-être faut-il regarder les chiffres autrement. Pas seulement comme des records, mais comme des signaux à décrypter. Interroger ce qu’ils disent du présent et du futur de la littérature.
Sources :