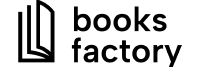Bien que le monstre cousu de fragments de corps humains soit l’une des icônes les plus reconnaissables de la culture pop, la femme qui lui a donné vie reste souvent dans l’ombre de son œuvre. Mary Shelley n’était pas une dame typique de l’époque victorienne. Sa vie ressemble à un conte gothique plein de rébellion, de romances, de voyages et de pertes douloureuses. Pour les auteurs et éditeurs contemporains, l’histoire de Shelley est la preuve que la grande littérature naît d’émotions authentiques et du courage de briser les schémas.
Voici huit faits de la vie de Mary Shelley qui jettent une lumière nouvelle sur le processus créatif de l’un des romans les plus importants de l’histoire.
1. « Frankenstein » est né d’un pari durant l’« Année sans été »
La légende raconte que l’idée du roman a surgi dans des circonstances inhabituelles. En 1816, Mary, son bien-aimé Percy Bysshe Shelley et leur fils se rendirent en Suisse pour passer du temps avec Lord Byron à la Villa Diodati. Le temps était cependant épouvantable – suite à l’éruption du volcan Tambora, cette année fut nommée l’« Année sans été ». Des pluies torrentielles et une aura lugubre emprisonnèrent la compagnie à l’intérieur.
Pour tuer l’ennui, Lord Byron proposa un concours pour écrire la meilleure histoire de fantômes. C’est alors, inspirée par des conversations nocturnes sur la nature de la vie et les expériences d’Erasmus Darwin, que Mary eut la vision d’un « pâle étudiant des arts impies agenouillé près de la chose qu’il avait assemblée ». C’est ainsi que naquit l’ébauche de « Frankenstein ».
2. Elle n’avait que 19 ans lorsqu’elle a commencé à écrire son chef-d’œuvre
Les débutants d’aujourd’hui ont souvent l’impression qu’il faut attendre toute une vie pour écrire son magnum opus. Mary Shelley prouve le contraire. Lorsqu’elle a commencé à esquisser l’histoire de Victor Frankenstein, elle était adolescente.
Le roman fut achevé lorsque l’auteure avait 20 ans, et publié (anonymement) lorsqu’elle en eut 21. La maturité émotionnelle et la profondeur philosophique de ce livre continuent d’étonner les critiques aujourd’hui, compte tenu de l’âge de l’auteure.
3. Apprendre à écrire dans un cimetière
L’éducation de Mary était atypique, même pour les standards de l’époque. Fille de l’éminente féministe Mary Wollstonecraft (décédée peu après l’accouchement) et du philosophe William Godwin, elle grandit dans une atmosphère de bouillonnement intellectuel.
Cependant, le détail le plus imagé de son enfance est le lieu où elle apprit ses lettres. La petite Mary s’échappait souvent au cimetière de St Pancras Old Churchyard à Londres. C’est là, en traçant du doigt les inscriptions sur la pierre tombale de sa propre mère, qu’elle apprit à former ses premières lettres et à lire. Ce contact précoce avec la mort et la mémoire des ancêtres a fortement influencé sa sensibilité gothique ultérieure.
4. La marraine du genre science-fiction
Bien que « Frankenstein » soit souvent classé comme horreur ou roman gothique, les spécialistes de la littérature s’accordent à dire : Mary Shelley a créé le premier roman de science-fiction de l’histoire.
La différence clé réside dans le mécanisme d’animation du monstre. Les récits antérieurs reposaient sur la magie, les malédictions ou l’intervention de forces surnaturelles. Shelley a fondé son intrigue sur la science de l’époque – le galvanisme et l’électricité. La technologie et l’expérience, et non la sorcellerie, étaient la force motrice, marquant un tournant définitif vers la science-fiction.
5. Une vie marquée par une série de tragédies
Les ténèbres qui se déversent des pages de son roman n’étaient pas seulement une création littéraire. La vie privée de l’écrivaine était remplie de souffrance. Mary a enterré trois de ses quatre enfants, ce qui l’a plongée dans une profonde dépression.
Le sentiment de perte, de solitude et de rejet, décrit de manière si suggestive par le monstre de « Frankenstein », était un reflet direct des états émotionnels de l’auteure. La créature, qui désire l’acceptation mais rencontre la peur, est une métaphore de l’aliénation que Shelley a vécue après s’être enfuie de chez elle avec Percy Shelley, alors marié.
6. Un souvenir macabre dans le bureau
La relation entre Mary et Percy Shelley fut tumultueuse et se termina tragiquement. Le poète se noya lors d’une tempête en Italie en 1822, à l’âge de seulement 29 ans. Son corps fut incinéré sur la plage, conformément aux règlements de quarantaine, mais – comme le dit la légende – son cœur ne brûla pas.
Mary Shelley conserva cet organe. Pendant des années, elle garda le cœur carbonisé de son mari, enveloppé dans de la soie et l’un de ses poèmes (certaines sources parlent de pages d’« Adonaïs »), dans un tiroir de son bureau. Cette histoire semble tout droit sortie de ses livres et montre à quel point la vie de l’écrivaine était entrelacée avec le culte romantique de la mort.
7. Une vision prophétique dans « Le Dernier Homme »
Mary Shelley n’est pas l’auteure d’un seul roman. Son œuvre est beaucoup plus vaste, et « Le Dernier Homme » (« The Last Man »), publié en 1826, mérite une attention particulière.
C’est l’un des premiers romans post-apocalyptiques de l’histoire. L’action se déroule à la fin du XXIe siècle, lorsque l’humanité est décimée par la peste. Le protagoniste, Lionel Verney, observe l’effondrement de la civilisation, pour finalement devenir le dernier homme titulaire sur Terre, errant dans un monde dépeuplé. Cette vision, extrêmement déprimante et novatrice, n’a été pleinement appréciée que par les lecteurs modernes.
8. Collaboration éditoriale ou domination ?
Pendant des années, le rôle de Percy Shelley dans la création de « Frankenstein » a fait débat. On sait que le mari de Mary a édité le manuscrit, apportant des corrections stylistiques et suggérant des changements pour un vocabulaire plus sophistiqué.
Certains critiques du XIXe siècle ont même suggéré qu’il était le véritable auteur de l’œuvre. Cependant, l’analyse des manuscrits qui ont survécu jusqu’à ce jour confirme sans équivoque la paternité de Mary. La contribution de Percy se limitait au rôle d’un éditeur qui soutenait (bien que parfois avec trop de zèle) sa talentueuse épouse. C’est une leçon précieuse pour les auto-éditeurs modernes sur l’importance, mais aussi la délicatesse, de la relation entre auteur et éditeur.
BONUS : Un rêve réalisé après des années
Pour finir, nous avons une surprise pour tous les amateurs de cinéma et de littérature. L’adaptation tant attendue de « Frankenstein », réalisée par le visionnaire du cinéma d’horreur Guillermo del Toro, vient d’apparaître sur Netflix.
Fait intéressant, la création de ce film était un rêve du réalisateur depuis son enfance. Del Toro a mentionné à plusieurs reprises dans des interviews qu’étant garçon, il s’identifiait au monstre et non à son créateur, ce qui promet une perspective totalement nouvelle et profondément humaniste dans le film. Le casting comprend notamment Oscar Isaac dans le rôle de Victor Frankenstein et Jacob Elordi dans celui du Monstre. C’est une excellente occasion de vérifier, après la lecture de l’original, comment le maître mexicain a interprété les peurs et les espoirs de Mary Shelley dans le cinéma contemporain.
L’histoire de Mary Shelley est la preuve que les meilleures histoires naissent à la jonction du talent, du travail acharné et de l’expérience de vie. Son héritage chez Books Factory, nous le considérons comme une inspiration pour prendre soin de chaque mot imprimé.